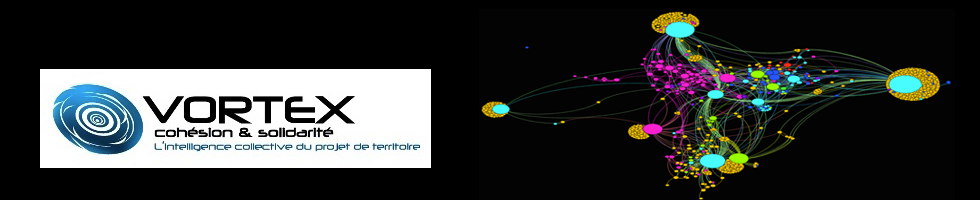
Dernières actualitésConstruction d'un système d'enseignement supérieur et de Recherche en BretagneHESRIB 2015: Ces deux journées ont permis de (re)visiter l'histoire complexe d'un territoire qui s'est construit un espace d'Enseignement supérieur et de recherche atypique. Aléas, blocages, élans, synergies et opportunités exceptionnelles rythment 70 années étonnantes. La Galerie de portraits se trouve ici ! Villes bretonnes : Enquête INSEEÀl’échelle européenne, des conditions de vie plutôt favorables dans les agglomérations bretonnes. Une enquête INSEE sur les villes moyennes en Bretagne
Interview Pierre DUBOISLes mutations universitaires et l'ancrage territorial décodées par le blogger Pierre Dubois. C'est à lire ! Sept questions à Pierre Dubois, universitaire et historien des universités, auteur du blog « Histoires d’Universités ». |
Interview Pierre DUBOISLes mutations universitaires et l'ancrage territorial décodées par le blogger Pierre Dubois. C'est à lire ! Sept questions à Pierre Dubois, universitaire et historien des universités, auteur du blog « Histoires d’Universités ».
Strasbourg, le 2 avril 2014
Oui bien entendu. Les dernières nouvelles laissent penser qu’Arnaud Montebourg récupère la recherche. Ça veut donc dire que les coopérations entre universités et grands organismes vont tomber. Le mot « université » n’a pas été prononcé une seule fois dans le remaniement ministériel. Si la recherche est dans un grand ministère avec l’Industrie, l’université est morte. Elle sera assassinée, et, de plus, avec un gaspillage d’argent public. C’est le pire des scénarios. C’est la fin de l’université « traditionnelle » dans la meilleure acception du terme (formation et recherche) ; la recherche disparaîtrait des universités. Il y a bien sûr aussi un problème interne aux universités avec les regroupements imposés par la loi de juillet 2013, qui se font selon un modèle où l’on va diviser le travail, allonger la ligne hiérarchique, disperser les salaires avec un lot de précaires à bas salaire et des salariés très bien payés : ce n’est pas l’université que j’ai envie de voir. Et avec, comme conséquences, que les dirigeants d‘universités regroupées en COMUE vont être des gens coupés des réalités du terrain. On les appelle les apparatchiks. Pour eux, le seul but est de garder une place jusqu’au terme de leur vie active. Vient périodiquement le temps du jeu des chaises musicales où des universitaires, dans des universités croupions, ne se battent plus que pour garder une place. Mon analyse est donc pessimiste, puisque les nouvelles de ce jour[i] montrent que le ministère de l’enseignement supérieur est celui dont on ne parle pas ni dans les ministres partants, ni dans les futurs ministres. C’est-à-dire deux millions cinq cent mille étudiants, tout autant d’électeurs, dont on ne parle pas, qui sont dans la nature ! On ne pense pas à eux, c’est un mauvais modèle, je ne l’aime pas car il est incohérent : bureaucratie et apparatchiks au sommet et des managers tueurs de coût à la base. Le reste des enseignants sont morts car il n’y aura pas besoin d’un doctorat pour monter quelques cours à distance avec une vidéo. On entend beaucoup d’universitaires, se qualifiant eux-mêmes de chercheurs de base, témoigner de leur incompréhension, voire de leur colère, face aux décisions prises par leur hiérarchie, les apprenant parfois par la presse. Jusqu’où d’après vous peut aller un tel décollement ? Ce décollement aura-t-il une portée durable ou témoigne-t-il d’un trop classique frein au changement ? Non, ce n’est pas du tout un frein au changement. Le corps professionnel enseignant est en train de mourir. Ça c’est clair : il ne peut pas rester dans l’état. Si on fait un peu d’histoire, même d’histoire récente, jusque dans les années 70s-80s, on recrutait des enseignants-chercheurs. Aujourd’hui on recrute des chercheurs-enseignants. La priorité pour un nouveau recruté, un maître de conférences par exemple, c’est de publier. Et on entraine même, dans cette injonction à publication, les doctorants, les ATER. Ne compte plus que la recherche pour être visible. La mission d’enseignement devient donc marginale. Un exemple symptomatique de la chose : on recrute un chercheur-enseignant très pointu parce qu’il est un des meilleurs en France ; bien sûr on le recrute sur un poste de MCF et on lui « colle » un enseignement en licence. Il n’en a pas envie puisqu’il a été recruté parce que pointu en recherche et le labo qui l’a recruté est content puisque c’est un gars qui va écrire des publications dans les meilleures revues du monde, …mais il va aussi devoir enseigner en premier cycle et ça, ça ne l’intéresse pas. Qu’est-ce qu’il fait ? - et c’est assez marrant puisqu’on dit que la formation universitaire se fait par et à la recherche - eh bien, pour faire son cours à l’économie en premier cycle, il va chercher du contenu à enseigner dans les manuels des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont à jour du point de vue des dernières connaissances produites. Ce sont donc les enseignants des classes préparatoires qui font des bons enseignements, et les jeunes universitaires les copient pour faire des cours en licence à l’économie. Donc les chercheurs-enseignants vont être sauvés mais le problème c’est qu’une partie du corps enseignant, qu’on appelle les non-publiants qui peuvent être de bons enseignants, qui peuvent être au courant des avancées de la recherche, et qui enseignent aussi en premier cycle, ces gens-là sont morts. Ils n’ont plus de place dans une université où l’importance de la fonction recherche est fondamentale. Que faire de ces gens-là jusqu’à leur retraite ? Les syndicats sont bien sûr hostiles à la modulation des services. Moi je n’y suis pas hostile car si un enseignant ne veut plus faire de recherche, il n’y a pas d’opposition à ce qu’il enseigne davantage. Cela pose la question du modèle d’enseignement dont nous avons besoin en premier cycle. Faut-il vraiment des EC en premier cycle ? Les bilans sociaux publiés par les universités ne disent rien de la composition du corps enseignant en 1er cycle : quelques professeurs, quelques MCF qui ne sont pas publiants, des doctorants, des ATER, des professeurs agrégés ou certifiés et des contractuels qui ne sont pas forcément reconduits d’année en année du fait de la pénurie croissante de moyens dans les universités. Le corps enseignant universitaire est de plus en plus éclaté : la progression constante du stock de connaissances explique le repliement disciplinaire, voire sous-disciplinaire. Des EC peuvent survivre s’ils créent des niches qui les protègent. Il en résulte la mort de la collégialité ; ceci est à l’origine du fossé qui se creuse avec leur hiérarchie. Je ne comprends pas que des EC acceptent d’être directeurs de composante dont la seule fonction est de faire des économies, que des gens se fassent élire dans des conseils centraux puisque ce sont les équipes de direction qui préparent et manipulent tout. Les décisions à prendre sont devenues tellement complexes que les conseillers n’ont pas le temps d’étudier les dossiers et n’ont pas les compétences nécessaires. Qui, d’après-vous, pilotera demain les universités, la recherche : L’état ? Bruxelles ? Les régions ? Les présidents dirigent les universités et l’Etat les protège. Traditionnellement, ce sont les universitaires qui dirigent, orientent et prennent les décisions pour le progrès des universités. Les universitaires qui sont à la tête d’universités fusionnées, eux, n’ont plus de contact avec la recherche. Ce ne sont plus des EC, ils sont devenus des « fonctionnaires élus ». Le mode de scrutin dans les grandes universités (voir les résultats à Paris 7 où les médecins l’ont remporté mais c’est le jeu électoral parce qu’ils sont à la fois professeurs à l’université et professeurs hospitaliers) contribue à l’éclatement du monde universitaire. Il y a encore des candidats à la présidence ; à un moment je croyais qu’il n’y en aurait plus mais maintenant ils ont de telles primes et en plus ils bénéficient d’une certaine reconnaissance sociale, ils sont présents dans les réseaux locaux - ce qui a du bon -, ce sont des personnalités au niveau d’un département ou d’une région. Mais ce ne sont plus des gens qui connaissent la réalité du terrain de la formation et de la recherche. Donc on peut se poser la question : « est-ce que les Universités - mais j’aimerais bien que les Universités ne soient pas seulement des Universités de recherche - pourraient décider d’adopter un modèle de gouvernance avec d’un côté une direction exécutive non composée d’universitaires, qui organise toutes les décisions qui ont un impact financier, et avec d’un autre côté un sénat académique qui définit la stratégie de recherche et la mutation nécessaire des enseignements ? Revenons sur le rôle des régions. Ce sont elles qui vont drainer les fonds européens à travers la smart specialization qui leur donne une spécificité et une visibilité à l’échelle européenne. Quelle place vont-elles prendre dans l’université du III° millénaire dans un « jeu » qui semble évoluer, pour les questions opérationnelles du moins, vers une Europe des régions plutôt qu’une Europe de nations ? Alors là je répondrais que j’y connais beaucoup moins que toi [rires]. Moi, la région, j’y crois. Parce que c’est quand même la chance pour le citoyen d’avoir une proximité avec les élus. Pas en Ile de France bien entendu, mais dans une région comme l’Alsace, les élus on les connait, on les rencontre, on peut les voir et discuter. Ils ont la légitimité de l’élection. En plus les régions ont, depuis la décentralisation du début des années 80, une compétence sur les formations supérieures des lycées, sur l’apprentissage et donc les formations professionnelles ; c’est une voie de l’ES à renforcer pour que davantage d’étudiants soient en contrat d’alternance, que plus de jeunes aient des contrats de qualification pour n’avoir pas besoin d’un diplôme de 2ème cycle tout de suite… Au niveau des régions, les politiques peuvent donc être claires, plus humanistes et surtout lisibles. Même si le nombre des régions reste trop élevé, on peut comprendre le rôle des uns et des autres. Donc je suis très favorable à la décentralisation avec une accentuation des compétences c.a.d. une délégation de compétences accrues en matière d’offre et de cartes des formations de 1er cycle, mais le problème français c’est que 1) on a de trop petites régions -en Alsace, la région où je vis ma retraite, c’est trop petit- et 2) on ne sait pas faire de la décentralisation c.a.d. qu’on la double d’une déconcentration : l’État est toujours là au niveau départemental et régional. En étant provocateur je dirais « il y a trop de fonctionnaires ». Quand on regarde l’évolution de la fonction publique d’état à partir de 1980, première étape de décentralisation, on voit monter en puissance la fonction publique territoriale, ce qui est logique, mais la fonction publique d’État ne diminue pas alors qu’elle aurait dû diminuer. En France, on ne sait pas vraiment régionaliser : l’État est toujours présent pour contrôler, vérifier… Une des raisons pour laquelle le referendum sur une collectivité unique en Alsace a échoué (à part bien entendu le mode électoral), c’est la rumeur de la suppression de la préfecture à Colmar, présentée comme une conséquence directe de la collectivité unique. Concernant la taille critique des régions, ce serait sans doute plus intéressant pour l’Alsace de fusionner avec le Bade-Würtemberg que de fusionner avec la Lorraine !!! Mais c’est l’État qui veut toujours tout contrôler. C’est la même chose dans les universités qui sont pourtant autonomes. En cas de problème, on demande la version de l’administration centrale pour connaître la règle. On n’ose pas l’autonomie ! Peut-on franchir une étape vers une vraie décentralisation et de grandes régions où les citoyens voteront (avec un système de péréquation prévu par la loi pour équilibrer la répartition des richesses) ? Un autre problème est que les régions ne peuvent pas lever l’impôt, ce qui constitue une limite du système français. La marche de manœuvre financière des régions est faible et, quand l’État annonce 10Mds de moins pour les collectivités territoriales, ceci n’est pas donner une chance aux décisions de proximité qui sont souvent plus réalistes, potentiellement plus efficaces et plus lisibles. Le droit à l’expérimentation ? Je suis très « bipolaire » sur cette question : quelquefois pour, quelques fois contre. L’expérimentation ça peut être une manière de botter en touche. On veut faire passer une réforme, on fait une expérimentation, comme ça on satisfait les gens ; si ça échoue, on n’en parle plus, si ça réussit, il n’est pas garanti que la réforme s’élargisse au champ national. C’est le côté un peu bidon de l’expérimentation. C’est ce qui va être fait pour les premières années de médecine. C’est aussi un manque de courage politique : on n’ose pas faire une loi, de peur qu’elle attire un grand nombre de mécontentements, qu’elle ne soit pas votée. Mais l’expérimentation peut aussi permettre de faire avancer les choses. Elle permet d’envisager toutes les conséquences possibles, que l’on peut mesurer. On explore et cela permet d’identifier des facteurs importants que l’on n’avait pas identifiés au départ. Cela peut permettre de connaître l’enchevêtrement des facteurs de réussite et d’échec, de faire une phase d’évaluation, de modifier le contenu même de l’expérimentation, bref de progresser dans la bonne voie du progrès. Aujourd’hui, toutes les lois exigent une phase d’évaluation a posteriori. Je me souviens d’un de mes présidents d’université auquel je m’opposais en CA à propos de la création d’un SAIC (dans son mode de fonctionnement, l’Université pouvait remplir exactement les mêmes missions sans SAIC) ; mon président l’a emporté parce qu’il a promis de faire une évaluation de ce SAIC au bout d’un an. Bien sûr, cette évaluation n’a jamais été faite. C’est aussi le cas pour les lois. Donc c’est de l’évaluation bidon. Vous connaissez bien l’Alsace –votre région- et la Bretagne. Comment analysez-vous les regroupements qui s’y font ? Existe-t-il des stratégies de territoire ou relèvent-ils d’un simple pragmatisme. Sont-ils liés à des spécificités ou des cultures particulières ? Oui, c’est bien lié à une culture particulière. Bien que n’étant en Alsace que depuis cinq ans, je commence à bien maîtriser son histoire. Les 3 universités de Strasbourg ont eu raison de fusionner vite, vite. Il y avait une proximité de campus qui y poussait. Ce qui a par contre été raté c’est de ne pas avoir inventé un nouveau modèle organisationnel ; c’est le modèle de division du travail, de hiérarchisation qui a été retenu. Ce qui a également été raté l’a été du fait de l’université de Mulhouse (Strasbourg n’avait pas besoin de la fusion avec Mulhouse, mais Mulhouse en avait objectivement besoin). Le refus de la fusion a été un échec pour l’Alsace et quand on voit la convention d’association qui a été signée la semaine dernière, on constate que c’est une absorption de fait de l’université de Mulhouse par l’université de Strasbourg ; l’Université de Haute-Alsace sera sous la marque de l’U de Strasbourg (UNISTRA), et les EC de l’UHA devront signer leurs publications en premier sous le nom de l’Université de Strasbourg. Bien sûr, il reste à Mulhouse une présidence, un agent comptable et un budget mais quand on voit que cette université est structurellement en déficit (elle va, de mon avis, être mise sous tutelle du Recteur l’année prochaine) et que ses ressources vont mécaniquement diminuer. Sur les masters, les formations, c’est Strasbourg qui emporte le marché. J’espère que la fusion se fera rapidement mais selon mon modèle d’Université de recherche et de masters-doctorats avec des sites de 1er cycle de proximité dans toute l’Alsace, entre 25 et 30, juridiquement autonomes mais associés aux universités de recherche. Ce modèle n’est certes pas prêt de voir le jour, mais, chaque jour qui passe, l’actualité me donne davantage d’arguments. Le Bretagne, pour ce que j’en connais, c’est une autre configuration. J’approuve la fusion de Rennes 1 et de Rennes 2, c’est logique. Nantes, elle, n’a pas été dissociée en 1968, Rennes l’a été. Mais il existe deux autres universités en Bretagne, l’UBO et l’UBS. Si c’est une COMUE bretonne, Rennes fusionnée dominera les deux autres. Sans le dire, c’est la COMUE qui va gérer l’ensemble par le biais des nouveaux recrutements. Ce seront des enseignants de la COMUE et non de l’ensemble des universités. Comment les universités non rennaises peuvent-elles s’en sortir ? Sans doute en s’appuyant sur les réseaux territoriaux avec les entreprises ; Il faudra une gouvernance hyper légère basée sur les projets, sans création d’une institution de gouvernance ce qui rajouterait une couche institutionnelle - ce qui est forcément voué à l’échec. C’est une configuration qui peut se dessiner en Bretagne. Maintenant, l’histoire d’une COMUE avec les Pays de Loire, là on aurait vraiment une grande région. Si on la compare à l’Alsace, on voit que la France a un vrai problème avec la taille des régions. Une COMUE sur les deux régions va aboutir à un grand nombre de couches institutionnelles qui permettront, via un jeu de chaises musicales, aux dirigeants de garder une place jusqu’à la retraite. C’est un modèle bien français basé sur la bureaucratisation. On aura une merveille de stupidité française. Vous avez été récemment sanctionné par EducPros, la voix du Ministère comme on disait la voix de l’Amérique ou la voix de la Russie dans les années 60s. Il semble que, une fois de plus, la pensée unique ait frappé. Le monde universitaire est pourtant celui qui, de tous temps et en tous lieux, s’est opposé aux endoctrinements historiques. Ce cancer a-t-il réussi à gagner notre communauté ? Peut-on encore parler de communauté ? EducPros s’est créé au moment du mouvement des enseignants sur la réforme des statuts en 2009. La construction s’est faite sur le mode d’une plate-forme gratuite, mais appuyée sur les ressources du groupe L’Etudiant et de l’Express. Elle a associé des articles de journalistes et de pigistes et des chroniques de blogueurs « au service des professionnels de l’enseignement supérieur ». EducPros s’est créé contre un autre modèle, celui de l’Agence Education Formation (AEF), modèle payant et traditionnellement « lucratif » dans une pyramide capitaliste en chaîne. AEF a un corps de journalistes beaucoup plus étoffé et qui réussit à sortir les informations avant tout le monde. Mais l’abonnement ne peut être pris par des individus, les abonnés sont les universités. AEF ne peut donc mécontenter celles-ci… pour qu’elles continuent à acheter l’abonnement. Elle contourne cette difficulté en procédant à des interviews qui n’engagent que la personne interviewée qui, elle, peut critiquer. C’est un modèle très performant pour le suivi de l’actualité immédiate avec, derrière, l’ORS qui publie des dossiers fort bien documentés. Qu’est devenu le modèle originel d’EducPros ? Au début les premiers blogs étaient nommés « communauté de bloggers ». C’étaient pour la plupart de grands universitaires, dont Claude Thélot, ancien directeur de la DEP. Moi, on est venu me chercher parce que je bloggais sur Le Monde, je bloggais beaucoup sur le mode critique et c’était bienvenu. J’ai eu plusieurs rappels à l’ordre en 3 ans et demi. J’ai bloggé sur les propos du directeur qui avait annoncé la fermeture du CEREQ et, suite à une menace de diffamation, j’ai dû retirer ma chronique. J’ai compris qu’EducPros se considérait comme responsable des propos des bloggers. J’étais le seul ou presque à faire des reportages alors que les autres faisaient des analyses sur la base de leurs expériences ou de documents. S’est alors posée pour moi la question du financement parce que je ne pouvais pas payer sur ma retraite les frais de reportage. Il y a eu un niet catégorique d’EducPros même s’il me payait de temps en temps une chambre d’hôtel. Et toujours des rappels à l’ordre du genre : « M. Dubois, vous allez trop loin en disant que M. Dizambourg et S. Bonafous sont ensemble et forment un couple ». Ce n’est pas une attaque ad hominem puisque c’est un fait et que je soulignais simplement qu’il pouvait y avoir un conflit d’intérêts, l’un étant président de Paris-Est, l’autre à la DGESIP et là je n’ai pas cédé. Et il y eu cette surprise du courriel du directeur de la rédaction, du 19 février 2014, me disant : « M. Dubois vous avez publié des images d’un goût douteux ». Si j’avais eu un coup de téléphone plutôt qu’un courriel, j’aurais sans doute enlevé ces images car elles ne sont pas toujours drôles et en plus elles n’ont pas forcément de valeur ajoutée par rapport au contenu de la chronique. Mais surtout, la critique a porté sur le fait que je donnais la parole à des opposants à la réforme Fioraso et que mon blog s’était radicalisé. Mes critiques s’adressaient au gouvernement socialiste ; je vote socialiste et continuerai à le faire mais je veux avoir le droit de critiquer une politique si j’estime qu’elle est mauvaise. J’ai critiqué la loi Fioraso, j’ai donné la parole à des opposants, les défenseurs de la loi ne m’ont rien demandé. Je considère que c’est une atteinte à ma liberté d’expression et aux libertés académiques. Le droit d’écrire et de publier est, pour les universitaires, reconnu par la Constitution. Je ne pouvais pas accepter de céder là-dessus et donc le blog a été dissocié par le directeur de la rédaction. J’ai donc créé un nouveau blog, ce qui ne va pas sans difficulté pour maintenir le lectorat atteint sur EducPros, car j’étais le chroniqueur le plus prolifique et le plus lu. Au début, j’avais demandé à EducPros de créer une vraie communauté de bloggers pour réfléchir ensemble à une vraie stratégie. Très peu sont venus à la seule réunion convoquée. Pour le nouveau blog, j’ai lancé un appel pour être rejoint par d’autres chroniqueurs mais c’est resté sans réponse à ce jour. Ce serait pourtant souhaitable car je ne détiens pas la vérité à moi tout seul. Je considère que l’accès à la parole pour les universitaires est plutôt en diminution y compris pour les publications scientifiques qui poussent de plus en plus à publier dans les meilleures revues, de langue anglaise, ce qui exclut nombre d’universitaires. C’est donc de la grosse artillerie, mais pas risquée du point de vue scientifique (voir les AAP de l’ANR où il faut avoir la garantie de publier dans la durée du contrat) ; il n’y a donc plus de prise de risque ! Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose ? J’ai réfléchi à cela et la question, c’est une vraie question, est : « Quand est-ce qu’on devient un vieux con ? » J’y réponds en disant que cela commencera quand je ne pourrai plus faire de reportages. Je ne veux pas faire un blog de documentation. J’ai besoin d’aller voir sur le terrain car c’est comme cela qu’on comprend les choses. En allant rencontrer les SHS à Metz la semaine dernière, j’ai compris encore mieux le statut des sciences sociales, c’est-à-dire : ce n’est plus rien. Je pense à mon ancien président de Lille 3 qui continue, même à 74 ans, à aller à son laboratoire de mathématique tous les jours ; il considère que l’activité est une condition de la santé !... Mais pas n’importe quelle activité ! [i] L’interview de Pierre Dubois a eu lieu à Strasbourg dans la matinée du 2 avril quelques heures avant l’annonce de la nomination de Benoît Hamon à la tête du MENESR. |